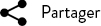In Situ. Revue des patrimoines, appel à contributions : « Les patrimoines de l’érotisme »
Date limite d’envoi des contributions : 15 janvier 2026
The Heritage of Eroticism
Deadline for proposals: January 15, 2026
Morwena Joly, conservatrice du patrimoine, Centre des monuments nationaux
Annabel Poincheval, inspectrice de la création, direction générale de la Création artistique
Les patrimoines de l’érotisme, souvent relégués aux marges de l’histoire culturelle et artistique, méritent une relecture attentive à la croisée des regards disciplinaires. De l’art antique aux productions contemporaines, de la littérature clandestine aux objets de culte, de la tradition orale aux archives privées, l’érotisme traverse les siècles en laissant derrière lui des traces multiples, parfois enfouies, parfois revendiquées. Ce numéro souhaite interroger les modes d’identification et d’acquisition, les formes de conservation, de représentation et de transmission de l’érotisme en tant que patrimoine matériel, immatériel, symbolique ou politique. Comment l’érotisme se constitue-t-il en patrimoine ? Qui en sont les passeurs, les gardiens, les censeurs ? Quelles sont les tensions entre mémoire, tabou et réappropriation ? En quoi les œuvres, les lieux, les récits érotiques participent-ils d’une mémoire collective ou de contre-cultures invisibilisées ? Ce numéro invite à explorer l’érotisme au prisme des problématiques patrimoniales : archives, musées, dispositifs de médiation, pratiques sociales, traditions populaires, etc., jusqu’à la période contemporaine.
Les nombreuses représentations artistiques et culturelles de l’érotisme – ou plutôt des érotismes – ont récemment fait l’objet d’un regain d’intérêt : expositions, ouvrages, numéros spéciaux de revues, colloques, journées thématiques organisées ces dernières années par le musée d’Orsay ou la Bibliothèque nationale de France. Le champ de la création participe de ce regain d’intérêt, par la récurrence du corps érotisé dans le spectacle vivant et les arts visuels.
L’érotisme est ici entendu comme une représentation esthétique du désir sensuel à travers le corps ou son évocation. Non-dits, imaginaire, fantasmes, dont l’inspiration varie selon les époques et les pays, mais aussi selon les conceptions culturelles de la pudeur, des interdits et des transgressions. Il s’agit, dans ce numéro d’In Situ. Revue des patrimoines, de s’interroger sur la patrimonialisation, la préservation, la monstration et la valorisation des œuvres, des objets ou des traces attachés à l’histoire de l’érotisme et de ses représentations en France comme à l’étranger.
Les propositions s’inscrivant dans une approche pluridisciplinaire (histoire, anthropologie, histoire de l’art, sociologie, études de genre, études queer, littérature, droit, muséologie, etc.) sont encouragées ; elles traiteront notamment des questions suivantes (non exhaustives) :
- érotisme et histoire de l’art : représentations, censures, détournements ;
- lieux et espaces du patrimoine érotique : musées, bibliothèques, lieux de mémoire ;
- collectionneurs et collections de curiosa : constitution, conservation, accès ;
- mémoire du désir et patrimonialisation des corps ;
- patrimoine érotique dans les sociétés extra-occidentales conservé dans les institutions européennes ;
- érotisme, colonialisme et réappropriations postcoloniales ;
- genre, sexualité et pouvoir dans les politiques de patrimonialisation et de valorisation ;
- pratiques contemporaines : art engagé, performance, militantisme, queerisation du patrimoine.
L’approche concerne autant le patrimoine matériel qu’immatériel, ainsi que la réflexion sur la notion de « hors-champ » patrimonial. La valorisation de ce patrimoine de l’érotisme est au cœur d’un paradoxe, entre l’occulté et le dévoilé, à l’image des « enfers » des bibliothèques. Lieux, œuvres, biens culturels, images fixes ou animées sont porteurs d’une mémoire qui demande protection, en raison de leur valeur sociologique et culturelle.
Comment les sociétés patrimonialisent-elles des formes architecturales ou sculpturales à contenu érotique, en tenant compte des enjeux de mémoire, de sacralité, de visibilité publique et de normativité morale ?
Il sera ici possible d’évoquer, par exemple :
- La patrimonialisation et la réception des représentations attachées à la sexualité et ses mythes ainsi que les traces de cultes priapiques dans l’Antiquité gréco-romaine – certains décors de villas ou de thermes (fresques, mosaïques, statuaire) faisaient du corps et du plaisir des thèmes pleinement visibles dans l’espace bâti…
- La présence de l’érotisme dans le décor architectural et peint de l’architecture médiévale et de la Renaissance européenne à la période moderne. De nombreuses cathédrales, églises gothiques (Reims ou Autun) et grandes demeures présentent des figures obscènes ou érotiques (sexes exhibés, femmes accroupies, scènes grivoises, grotesques, etc.) insérées dans les chapiteaux, modillons, miséricordes ou gargouilles.
Il faudra également interroger l’invisibilisation de l’érotisme dans la modernité patrimoniale. Depuis au moins la Renaissance italienne, la codification morale des espaces publics a souvent entraîné la suppression, la restauration « pudique » ou le déplacement des éléments jugés indécents. Cette « désexualisation » des monuments s’accompagne d’une certaine sacralisation du patrimoine. Les statues nues dans l’espace public, notamment féminines, ont souvent fait l’objet de controverses, et leur érotisme a été relu selon des cadres moraux variables ou les contextes nationaux ou coloniaux. La présence polémique de certaines formes d’érotisme dans l’espace public à la période contemporaine entre également dans ce champ d’étude.
Axe 2 – Conservation et valorisation d’œuvres et de biens culturels en lien avec l’érotisme
L’érotisme, en tant que forme d’expression culturelle et esthétique, occupe une place ambivalente au sein des institutions muséales. Bien qu’il traverse de nombreuses traditions artistiques et iconographiques à travers les siècles, il demeure souvent traité avec réserve, voire occulté, dans les espaces d’exposition. Cette marginalisation partielle s’explique par la tension persistante entre la valorisation patrimoniale et la perception sociale du désir sexuel comme relevant de la sphère privée, voire de la transgression.
Dans l’histoire des musées occidentaux, l’érotisme a longtemps été dissimulé ou euphémisé par des catégories esthétiques telles que le « nu artistique », la « scène mythologique » ou l’« étude académique du corps ». De nombreuses œuvres à contenu érotique explicite ont été exclues des expositions publiques, cantonnées aux réserves ou présentées dans des contextes didactiques visant à neutraliser leur potentiel subversif. Cette gestion institutionnelle du regard témoigne d’un processus de régulation culturelle du désir, au sein même d’espaces supposés voués à la conservation et à la transmission de l’héritage artistique.
Toutefois, à partir de la fin du xxe siècle, on assiste à une reconfiguration progressive du rapport entre muséographie et érotisme. La création de musées consacrés spécifiquement à l’érotisme (tels que ceux de Paris, Amsterdam ou Barcelone) ainsi que l’intégration d’œuvres érotiques dans des expositions temporaires thématiques signalent une volonté de légitimer ces productions en tant qu’objets de mémoire, d’histoire et d’esthétique. Cette évolution ne va pas sans débats : elle soulève des questions de réception, de censure, de contextualisation, mais aussi de hiérarchisation des patrimoines selon des logiques morales, sociales et genrées.
L’érotisme pose ainsi un double défi au musée contemporain : d’une part, celui de sa patrimonialisation – comment archiver, conserver, restaurer et exposer des objets ou des représentations fondés sur le désir, l’intimité ou la sexualité ? D’autre part, celui de sa médiation – comment le rendre accessible à des publics diversifiés, sans réduire sa portée à une esthétique du nu ou à une provocation anecdotique ? Ces questionnements prennent une acuité particulière lorsqu’ils sont abordés à travers les prismes des études de genre ou postcoloniales, qui invitent à interroger les conditions sociales de la production, de la légitimation et de l’exposition de l’érotisme dans les musées.
La place de l’érotisme dans les musées revisite les frontières entre art et obscénité, savoir et plaisir, légitimation et subversion. Elle met en lumière la manière dont les institutions culturelles participent à la construction sociale du regard, à la définition du patrimoine et à la sélection des objets dignes d’être conservés, transmis et montrés. Des exemples concrets doivent être convoqués comme le cabinet secret du Musée archéologique de Naples, le mobilier de Valtesse de La Bigne conservé au musée des Arts décoratifs à Paris, le musée Félicien-Rops à Namur (Belgique), les Enfers des bibliothèques, les collections de revues ou de photographies érotiques.
Ce champ de recherche invite à penser le musée non seulement comme un lieu de conservation, mais aussi comme un acteur actif de la fabrique du sensible et de la mémoire des désirs. Trois pistes de réflexion peuvent être envisagées :
- Comment les musées négocient-ils la patrimonialisation de l’érotisme entre légitimation esthétique, neutralisation discursive et gestion du tabou ? Il est ici question d’explorer les stratégies curatoriales utilisées pour exposer des œuvres érotiques, ainsi que les tensions entre visibilité publique et contraintes morales ou politiques.
- L’érotisme peut-il être légitimé comme objet patrimonial au sein des musées généralistes, ou reste-t-il confiné à des institutions spécialisées et périphériques ? Cette question permet d’analyser la place donnée à l’érotisme dans les musées dits « classiques » (Louvre, Orsay, British Museum) versus des lieux alternatifs ou communautaires.
- Quels dispositifs muséographiques permettent de représenter l’érotisme sans le réduire à une esthétique du nu ou à un spectacle voyeuriste ? Il s’agit de s’interroger sur la scénographie, les textes de médiation, le rôle du langage dans l’encadrement de la réception.
Axe 3 – Patrimoines de l’érotisme et création
Partant du postulat que création et patrimoine ne sont pas antinomiques, que les œuvres contemporaines font écho à la fois à l’histoire passée et au contexte qui les voit naître, les contributeurs pourront questionner l’évolution de la perception de l’érotisme à travers le prisme de la création.
Qu’elles soient plastiques, cinématographiques ou photographiques, les œuvres contemporaines empreintes d’érotisme s’en réfèrent à des codes, des symboles, des signes présents dans un imaginaire collectif véhiculé par d’autres œuvres, d’autres images, s’agissant de ces médias plus que centenaires. Le champ du roman graphique et de la bande dessinée pourra aussi être exploré, à travers divers auteurs, dessinateurs et albums parfois réservés aux adultes.
L’érotisme trouve aussi l’expression de sa puissance dans la création textile, dont l’intérêt récent pour la patrimonialisation peut poser la question de sa visibilité auprès du public. L’évolution de la mode marque pourtant celle du rapport au corps et à son érotisation, en particulier dans la mode féminine qui a vécu de grands bouleversements au cours du xxe siècle.
Axe 4 – Un Patrimoine immatériel à découvrir
Enfin, sur scène et en coulisse, l’érotisme ne saurait exister sans référence à son histoire, aux patrimoines qui l’ont construit. Qu’il s’agisse de spectacles d’effeuillage qui marquent l’acceptation de la nudité ou de costumes contemporains empruntant au vestiaire classique, l’image est détournée au profit d’une libération des corps. Dans le domaine chorégraphique, la centralité du corps donne lieu à un détournement des codes patrimoniaux, comme l’interprétation de ballets classiques dans une veine érotique, qui a pu faire bouger les codes de la danse ; ou l’histoire du cancan, promis à une inscription au patrimoine immatériel, qui témoigne d’origines subversives fondues aujourd’hui dans une popularité liée à une érotisation lissée et performative. Au cabaret, l’évolution de la considération des genres et de leur représentation reflète celle de la place de l’érotisme au fil du temps. Le patrimoine bâti de certains lieux de spectacle témoigne de l’érotisation de cet univers, où la rencontre est facile, recherchée et parfois clandestine, dans la salle, sur la scène ou entre scène et salle.
Les articles proposés devront contenir une part inédite d’expérience, de recherche, d’hypothèse ou de mise à jour ; ils ne sauraient donc reprendre un article déjà publié. Il est souhaité qu’ils soient largement illustrés, y compris par des exemples sonores et/ou audiovisuels. Ainsi pourraient-ils contenir un entretien vidéo ou en prendre la forme.
Si vous souhaitez contribuer à ce numéro, nous vous remercions d’envoyer votre proposition avant le 15 janvier 2026, constituée d’un résumé de 1 500 signes au maximum, ainsi que d’un court CV à
insitu.patrimoines@culture.gouv.fr
ou par voie postale :
Ministère de la Culture
Direction générale des Patrimoines et de l’Architecture
Revue In Situ. Revue des patrimoines
182, rue Saint-Honoré
75001 Paris
à l’attention de Nathalie Meyer
Envoyer une copie de votre proposition à :
Morwena Joly-Parvex : morwena.joly-parvex@monuments-nationaux.fr
Annabel Poincheval : annabel.poincheval@culture.gouv.fr
Les résultats des propositions retenues seront communiqués le 30 janvier 2026. Les textes eux-mêmes seront attendus pour le 15 juin 2026. La taille des articles sera comprise entre 15 000 et 35 000 signes.
Les recommandations aux auteurs concernant le nombre de pages ou d’images, les droits de l’iconographie, l’insertion de notes et de liens, etc., sont consultables sur le site de la revue : https://journals.openedition.org/insitu/32424
La rédaction de la revue
Direction générale des Patrimoines et de l’Architecture
Délégation à l’inspection, à la recherche et à l’innovation (DIRI)