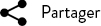Chères et chers collègues,
J’ai le plaisir de vous inviter à ma soutenance de thèse intitulée :
« Polychromie des portails et jubés gothiques : apport des sciences analytiques à l’histoire des techniques artistiques ».
Elle se tiendra le mardi 9 décembre à 14h30 à l’amphithéâtre Durand (cf plan PJ), Sorbonne Université, 4 Pl. Jussieu, Paris (5) devant le jury composé de :
· Pauline Martinetto, Maîtresse de conférences, Université Grenoble Alpes – Rapporteure
· Stephan Albrecht, Professeur, Université de Bamberg – Rapporteur
· Ina Reiche, Directrice de recherche, CNRS Lab-BC C2RMF – Examinatrice
· Sigrid Mirabaud, Ingénieure de recherche, Ministère de la culture – Examinatrice
· Géraldine Victoir, Maîtresse de conférences, Université Paul-Valéry Montpellier 3 – Examinatrice
· Étienne Anheim, Directeur d’études, EHESS – Examinateur
· Corinne Bélier, Conservatrice générale du patrimoine, LRMH – Invitée
· Damien Berné, Conservateur en chef du patrimoine, musée de Cluny – Invité
· Ludovic Bellot-Gurlet, Professeur, Sorbonne Université – Directeur de thèse
· Philippe Plagnieux, Professeur, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne – Co-directeur de thèse
Résumé :
Cette thèse porte sur la polychromie des portails et jubés gothiques sculptés entre le milieu du XIIe siècle et la fin du XIIIe siècle dans la moitié nord de la France. Elle s’appuie sur un corpus de 22 ensembles architecturaux, étudiés via le récolement des résultats de 50 ans d’activités au Laboratoire de Recherche des Monuments Historiques (LRMH) complétés par de nouvelles études, constituant un corpus de 319 coupes stratigraphiques, dont 71 nouveaux prélèvements, pour caractériser les matériaux, les procédés et l’organisation des chantiers de mise en couleur. Face aux lacunes des sources écrites médiévales, elle associe aux méthodes physico-chimiques de caractérisation « classiques » deux approches inédites dans ce contexte : la datation radiocarbone du blanc de plomb, qui permet de dater directement la synthèse du pigment, et les analyses isotopiques du plomb, qui renseignent sur l’origine de la matière première. Les analyses effectuées combinent observations optiques, analyses élémentaires (MEB-EDS, LIBS) et structurales (spectroscopie infrarouge, diffraction des rayons X et chromatographie).
Certaines des 22 mesures radiocarbone ont révélé des décalages significatifs entre datations stylistiques et synthèse du blanc de plomb, remettant en question les synchronies traditionnellement admises entre sculpture et polychromie. Ces résultats démontrent l’autonomie des campagnes décoratives par rapport aux programmes architecturaux et révèlent la complexité des temporalités de chantier. Les résultats d’analyses isotopiques du plomb montrent des origines géographiques compatibles entre le métal des scellements et celui mis en œuvre pour la fabrication du pigment, et permettent de discriminer des campagnes distinctes entre portails et jubé au sein d’un même édifice. La mise en perspective de l’ensemble des résultats des caractérisations des polychromies révèle une culture technique partagée (matériaux, mises en œuvre, recherche d’effets) tout en montrant une évolution technique en deux temps. Le XIIe siècle se caractérise par une standardisation des pratiques : préparations systématiques au blanc de plomb (majoritaire), hégémonie de l’outremer, emploi privilégié de matériaux coûteux (outremer, cinabre ou vermillon, or). Le XIIIe siècle marque une diversification technique avec l’émergence des préparations colorées (ocres), l’introduction de l’azurite comme alternative à l’outremer (un tiers des cas étudiés) et la complexification des techniques de dorure. La fourniture des matériaux de la couleur mêle importations lointaines (outremer afghan, cinabre espagnol, laque indienne) et productions ad hoc (blanc de plomb, minium, étain doré).
La convergence des palettes et procédés de la polychromie avec l’enluminure et la peinture murale indique une formation commune des artistes et artisans. Elle révèle une culture commune entre les différents domaines de la création médiévale sans gommer les adaptations spécifiques à chaque support. Ces traditions s’articulent aussi avec un savoir empirique d’ajustement.
Cette recherche établit que l’étude des matériaux et des techniques artistiques constitue une source historique primaire, apportant des éléments inédits sur l’organisation du travail et les réseaux d’échanges médiévaux. Elle fournit par ailleurs un socle matériel pour la conservation de ce patrimoine et restitue à la couleur sa place au côté de l’analyse formelle dans l’expérience artistique et spirituelle du Moyen Âge, ouvrant de nouvelles perspectives pour l’étude de l’art gothique.
Au plaisir de vous retrouver à cette occasion.
Bien cordialement,
Stéphanie Duchêne